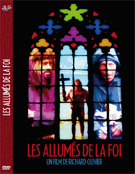La sortie en salle, le 21 juin à l’Actor's Studio de Marchienne de vie et de Petits meurtres ordinaires nous donne l’occasion de rencontrer Richard Olivier. Veste de cuir brun, chemise en jeans, cheveux gris argent, look rive gauche. A côté de lui, trottine Caillou.
Richard Olivier : Marchienne de vie - Petits meurtres ordinaires
Entretien avec un cinéaste passionné
L’espérance des lendemains ce sont mes fêtes. Léo Ferré, Pauvre Ruteboeuf
Cinergie : La sortie simultanée de Marchienne de vie et de Petits meurtres ordinaires…
Richard Olivier : …meurtres imbéciles, non passionnels, meurtres névrotiques : la place de leur auteur est autant la prison que l’asile psychiatrique. Il a d’ailleurs été arrêté. C’est un de mes amis qui a découvert, au petit matin, la première victime, rue de Flandre, près de la Maison de la Bellone. Juste en face, il y a un petit commerce tenu par une mère de famille, un commerce tout gentil, de perroquets, d’aras, d’oiseaux, de graines pour canaris. Vers 9h30 du matin, alors qu’on sait qu’il n’y a rien dans la caisse en ce début de journée, cette femme s’est faite assassiner. Jean, mon ami l’a découverte, gisant dans son sang. Je ne lis pas la DH ou la presse en général. J’ai commencé à enquêter sans savoir du tout où j’allais. Très rapidement, j’ai découvert un personnage étonnant – complètement marginalisé dans cette société – Thierry, un des fils de cette pauvre dame assassinée. Il a été très vite accusé d’avoir tué sa mère. Dès lors, le film a pris une autre dimension. Lorsque j’ai tourné le film, Thierry était toujours dans le collimateur de la justice. J’ai essayé de faire le portrait de ce quartier qui vivait dans la terreur, car le lendemain, dans le garage d’en face, une femme s’est faite assassiner à son tour. Deux meurtres à cent mètres de distance. Tous les commerçants du quartier étaient terrorisés, d’autant que le portrait-robot de l’assassin était nullissime. Pendant plusieurs mois, la police a enquêté en vain. Puis l’assassin s’est fait choper et, hélas c’était un maghrébin. Mais bon c’est comme ça.
J’ai appris, un peu avant tout le monde, que l’assassin avait été arrêté et j’ai foncé chez Thierry –victime de la rumeur lui attribuant le crime – qui, assistait aux informations en direct du 19 heures de RTL où l’on annonçait l’arrestation du meurtrier de sa mère.
C : Ce qui frappe, dans tes derniers films, c’est que tu donnes la parole aux marginaux, aux exclus du discours dominant. Il y a une séquence digne du cinéma burlesque dans Petits meurtres ordinaires, c’est la séquence du cimetière.
R.O. : Ce que j’adore dans le cinéma dit "du réel", c’est que tu découvres en filmant, même si tu maîtrises plus ou moins la ligne du scénario. Les personnages ne font plus attention à la caméra ou alors, elle est dans un coin de leur tête. J’ai affaire dans ce cas à des marginaux, mais pas seulement vis-à-vis de la société, des marginaux de marginaux. Thierry est un personnage que tu vois sur le parvis de l’église Sainte-Catherine avec des boîtes de Gordon. Sa mère était sa protectrice morale, physique et même matérielle. Je ne sais pas trop ce qu’il est devenu, j’aimerais bien le savoir car pour moi, rien n’a jamais de fin.
C'est vrai que j’adore le burlesque. Si je suis encore en vie, c’est parce que l’humour m’a sauvé. Dans cette société, sans humour, tu ne survis pas.
J’ai fait mon service militaire en Allemagne, passant mon temps à fréquenter des abrutis. Quand j’en suis sorti, j’ai passé mon temps à écrire des sketches. J’étais comédien, j’avais fait l’IAD, mais je suis très vite allé vers les textes que je produisais moi-même plutôt que vers ceux des autres. J’ai commencé dans un cabaret, rue de Flandre – là où a eu lieu ce crime dont je viens de vous parler – à La Cantilène. Puis, avec Gérald Frydman, on a commencé à conceptualiser des gags photographiques avec un personnage qui était le mien et que j’avais baptisé Pop. Je l’avais habillé tout en noir. Cela m’a sauvé la tête de me plonger dans ce non sense que je développais. Je suis un gagman, mais c’est un métier impossible en Belgique. J’ai développé cette vis comica. Même si je fais des films désespérés, j’éprouve le besoin de faire rire. Je prends mon pied en faisant rire et ça, j’y arrive à travers des pièces de théâtre comme Un amour de vitrine qui a été joué au Théâtre du Parc. La récompense, c'est quand une spectatrice vous dit : « Monsieur, pendant une heure et demi, vous m’avez fait oublier que j’avais le cancer ». Ce sont des phrases qui aident à vivre. Je dis souvent que nous faisons un métier de boxeur. Dans le métier de documentariste, on se voit refuser plus de projets que l’inverse, j’ai la gueule pleine de bleus, même si ça ne se voit pas.
C. : Dans Les allumés de la foi, tu nous présentes des personnages forts comme le Frère Antoine et Jean-Pierre. Le mariage à Montmartre c’est une farce ?
R.O. : Il a été organisé par Nadine Monfils qui est une copine depuis toujours, rue Lepic à Montmartre. Un dimanche, avec l’accord des autorités communales, ils ont organisé un mariage à la Coluche. Ça ne mange pas de pain, c’est gentil, et cela fait du bien à Christina. Jean-Pierre est, quant à lui, un gars d’une force incroyable. Il a passé 18 ans de sa vie en taule. Il a traversé 25 fois la Manche avec la croix du Christ attachée dans le dos. Il fait de l’haltérophilie, c’est un copain du Dalaï Lama, il connaît bien la société thibétaine. Aujourd’hui, les braquages et la marginalité criminelle c’est fini. Il se trimbale toujours avec une balle dans la tête qu’on n’a jamais réussi à lui extraire. C’est en prison qu’il a commencé à se passionner pour le Christ. Jean-Pierre, c’est Spartacus, il le dit dans le film : « si j’avais été là avec mes copains, avec nos glaives et nos frondes on l’aurait délivré et tant pis si on c’était fait prendre, c’est comme ça ». C’est un personnage pas possible. Personne ne lui demande de se mettre à l’eau avec une croix sur le dos. Tous les jours, il prend des douches glacées de deux heures, hiver comme été.
C. : Comment fais-tu pour dénicher de tels personnages ?
R.O. : Nadine Monfils m’a aidé. Elle aussi est intéressée par la marginalité, bien qu’elle en fasse des fictions tandis que je reste dans la réalité. Fictionnaliser Jean-Pierre ou Frère Antoine ce serait partir de la vérité pour arriver au mensonge. Je laisse la fiction à d’autres qui sont nombreux, j’en consomme en tant que spectateur, mais je n’ai pas envie d’en faire. Je n’ai pas de temps à perdre. Il y a des millions de films à faire sur la vie de gens que j’apprends à aimer. Jean-Pierre, je l’ai découvert la caméra au poing. J’avais rendez-vous à 10 heures, et un quart d’heure plus tard, je le filmais. J’ai découvert le personnage en même temps que ma caméra. La spontanéité rapproche de la vérité. Bien qu’il faille rester modeste par rapport à cela car on est très vite manipulé.
C. : Tes derniers films ont été filmés en numérique. Tu travailles seul à la prise de vues ?
R.O. : Je ne peux pas faire autrement. Je n’ai plus de fric. Cela me permet de ne pas devoir aller chercher de l’argent à gauche ou à droite. Il m’en faut un tout petit peu, et avec ce minimum, j’arrive à payer les techniciens au moment du montage, du mixage, de l’étalonnage de la musique.
Ma caméra numérique me permet de travailler sans équipe, mais même si j’avais eu un milliard de francs, je n’aurai pas fait un autre film. J’essaie de choisir des sujets qui conviennent au type de prise de vues que j’effectue, où il faut être quasiment seul avec ton sujet. La séquence chez Jean-Pierre, par exemple, j’étais coincé sans pouvoir me déplacer dans quinze mètres carrés.. Si j’avais eu un gars pour le son, je ne sais pas où il se serait mis. C’est donc parfois un problème physique résolu grâce à cette caméra légère.
Le cinéma du réel – je ne sais pas si c’est Henri Storck qui a trouvé le mot – s’avère utile avec le temps. Tout film devient une archive. Le problème des documentaristes est qu’il n’y ait pas d’autre mot pour désigner notre passion, notre activité : certaines personnes nous confondent avec les documentalistes ! Ce qui est plutôt comique.
C. : C’est une activité de cinéaste, non ?
R.O. : Oui, appelons-la comme ça.
C. : Quel effet cela te fait-il de sortir en salles ?
R.O. : Certaines salles commencent à s'équiper en DVD. Donc, pas besoin de kinescopage. Ce n’est pas que je ne veux pas le faire, mais je n’ai pas les moyens de payer un million de francs belges pour porter un film d’une heure sur pellicule 35mm. Je fais une tentative à l’Actor Studio avec Marchienne de vie qui est un film interdit à l’antenne depuis sa première diffusion le 6 février 1994. C’est un film dont beaucoup de gens ont entendu parler, beaucoup s’en souviennent aussi. C’est un film sur une région complètement marginalisée. Deux ans après, il y a eu l'affaire Dutroux et le monde entier s’est rabattu sur cette région. J’ai pensé qu’ils allaient repasser le film à la RTBF, mais non. Pourtant, il est révélateur du mal-être, du malaise de cette région. C’est un film émotionnel dont on ne sort pas indemne. Je l’ai proposé à RTL. Eddy De Wilde m’a répondu qu’il ne pouvait pas, puisque le film était coproduit par la RTBF, mais il m’a proposé d’en faire une suite et c’est comme ça que j’ai réalisé Au fond Dutroux. Je déplore une situation, je montre pourquoi des gens comme Dutroux pouvaient, dans ces milieux de ferrailleurs, être à l’aise comme un poisson dans l’eau.
C. : Tu nous dit que dans ton théâtre tu aimes faire rire, dans tes films ce n’est pas tout à fait pareil ?
R. O. : C’est un peu mon côté Dr Jekyll et Mister Hyde. C’est parce que je ne fais pas de la fiction. La plupart du temps, la vie des gens est terrifiante. On est obligé de filmer des vies marginalisées. Tout dépend comment tu prends les événements de ta vie. Jean-Pierre est un homme d’une grande force. Quand tu lui rappelles qu’il a fait 18 ans de prison, il hausse les épaules. Personnellement, après deux jours de taule, je meurs ! Un gars comme Jean-Pierre c’est rare : la plupart des gens sont extrêmement faibles. On est pas là pour filmer le bonheur. Aujourd’hui, les gens courent derrière le bonheur, ils sont à la recherche frénétique du plaisir. Chacun court du matin au soir en espérant être plus heureux à la fin de la journée, pour pouvoir acquérir des biens…tu vois un peu le désastre !
Au théâtre, j’aime entendre la salle réagir et rire. C'est une médecine. Si tu ne ris pas une fois par jour, c’est une journée perdue. Rire, c’est une sorte de caresse que tu te fais à toi-même. D’ailleurs, c’est une entrée en matière formidable pour draguer. Le rire, c’est l’antichambre du bonheur. Et si on ne rit pas, on peut sourire. Je ne ris pas tellement, je souris. On peut rire dans sa tête.
C. : Comment choisis-tu tes sujets ? Qu’est-ce qui te donne envie de creuser la réalité ?
R.O. : Les allumés de la foi a commencé avec un personnage qui s’appelle Frère Antoine. L’image centrale est un personnage posté sur le pont de l’autoroute A6, à hauteur de Mâcon avec une colombe en bois. Il saluait du matin au soir et du soir au matin les automobilistes qui se déplaçaient soit vers Lille, soit vers Marseille. Tu te dis, c’est un gag. Cela pourrait être du Buster Keaton. Sauf qu’il ne s’agit pas d’un gag mais d’un homme désespéré d’avoir été chassé du couvent de Cluny où il espérait être accepté pour vivre une petite vie de moine. Il s’est retrouvé dehors et, par désespoir, il n’a rien trouvé d’autre que de dessiner une colombe de la paix dans un morceau de triplex, de la peindre malhabilement et de la brandir sur un petit manche en bois pour saluer tous les gens de passage. La police a laissé faire, il ne faisait de mal à personne. Cela fait vingt ans qu’il salue les automobilistes. Ce qui est extraordinaire, c'est que cet homme a salué des dizaines de millions de gens qui l’ont vu. Je suis certain que les routiers qui font souvent le même chemin apprennent à le connaître. Certains klaxonnent ou lui font signe. Il ne fait de mal a personne et il donne quelque chose. A ses heures perdues, il taille de minuscules croix de bois. Il m’en envoie une chaque fois qu’il m’écrit une lettre. Il vit modestement, comme un moine.
La première fois que je l’ai vu, c’est dans un court métrage en noir et blanc d’une réalisatrice française. En allant passer quelques jours dans le Ventoux, je l’ai vu sur un pont ! Je me suis dit : « C’est mon moine » et je suis passé sous lui à cent vingt à l’heure. Depuis, il a fait une tentative de suicide, il s’est cassé 42 os. Donc maintenant c’est très difficilement qu’il rejoint son pont à une heure et demie de chez lui. Il ne le fait plus que le week-end. Sinon j’avais des amis qui me téléphonaient sur mon GSM pour me dire : « Richard, on vient de voir ton moine ! ». Cela fait longtemps que je rêve à lui et grâce à l’appui du WIP j’ai pu faire ce film que j’ai mis beaucoup de temps à faire. C’est un film qui peut faire du bien aux gens. C’est un film médicament.
C. : Tu utilises beaucoup Arvo Pärt dans tes derniers films.
R.O. : C’est incroyable ce type, tu as l’impression qu’il a composé pour toi. De plus en plus de gens le découvrent et l’utilisent. Il est tellement minimaliste, évocateur, c’est le Bergman de la musique. Mon souci permanent – qui ne m’est pas que personnel – est d’essayer de faire en sorte qu’on ne reste pas indifférent devant les images, qu’il y ait de l’émotion.
Un de mes premiers orgasmes intellectuels c’est Léo Ferré chantant Pauvre Ruteboeuf. avec à l’envers du 45 tours, Le Temps du Plastique. Putain, le pied que j’ai pris. Ce sont des trucs fondamentaux de ma génération. Ce sont des gens comme eux qui ont déclenchés des émotions qui font que certains se sont dirigés vers des métiers artistiques. La chanson, c’est un court métrage formidable. Combien de gens ne se sont-ils pas aimés sur une musique ? Beaucoup de gens sont sur terre grâce à des chanteurs, à des musiciens, comme Marvin Gaye.
La musique réunit les corps.